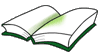| Titre de série : |
Thèse en Sciences et Technologies de l'Eau, de l'Energie et de l’Environnement |
| Titre : |
Analyse socio-économique et expérimentale des chauffe-eau solaires dans des régions arides et humides d’Afrique de l’Ouest |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
Claude Sara LEKOMBO |
| Année de publication : |
2025 |
| Importance : |
155 p. |
| Langues : |
Français (fre) |
| Résumé : |
L’Afrique de l’Ouest, avec son potentiel solaire abondant, présente des perspectives considérables pour la prolifération des chauffe-eau solaires (CES). Cependant, leur utilisation reste limitée par des obstacles économiques, techniques et sociaux. Cette thèse entreprend une étude socio-économique et expérimentale complète des CES dans des environnements arides et humides. Pour atteindre cet objectif, une méthodologie combinant des enquêtes de terrain et des études de cas a été adoptée. Des données ont été collectées à partir de différents types d’installations : un CES autostockeur dans une buanderie d’hôpital, un CES à capteur plan installé dans un hôtel et un autre dans un ménage à Ouagadougou, ainsi qu’un CES à tubes sous-vide dans un ménage à Lomé. Les performances des systèmes ont été évaluées sur une période de 12 mois, avec des mesures spécifiques concernant l’efficacité énergétique, la rentabilité économique, et l’impact environnemental des systèmes. Les données ont été complétées par des enquêtes sur les habitudes de consommation d’eau chaude dans les deux villes et par des analyses des politiques publiques et des dynamiques sociales locales. Les résultats indiquent des variations substantielles entre les régions : à Ouagadougou, 70 % des ménages utilisent le gaz en raison des subventions, tandis que 9 % adoptent le CES, contre seulement 0,4 % à Lomé, où le charbon de bois prédomine. La performance des CES diffère également entre les sites étudiés : à l’hôpital, le système génère 2 070 kWh, avec un rendement annuel de 38 % et un taux de couverture de 17 %. Le CES a démontré une moyenne de 770 kWh à l’hôtel, malgré des pertes de chaleur significatives (30-50 %), atteignant un rendement modeste de 14 à 17 %. A Lomé, un CES domestique a produit 1 055 kWh avec un rendement de 39 %, tandis qu’à Ouagadougou, une famille a consommé 1 313 kWh en un an, dont 1 243 kWh ont été fournis par l’énergie solaire, atteignant un rendement moyen de 38 %. Le temps de retour sur investissement varie de 2,4 à 10 ans, selon l’installation, et les CES réduisent les émissions de CO? de 0,3 à 1,75 tonne par an. Malgré la satisfaction de 80 % des utilisateurs, leur adoption est entravée par des coûts initiaux élevés, des défaillances techniques (par exemple des flotteurs défectueux), des systèmes sous-dimensionnés, un manque de financement et une coordination institutionnelle limitée. Néanmoins, les perspectives sont encourageantes en raison du potentiel solaire substantiel, de la maturité technologique des CES, des politiques favorables et des partenariats public-privé. Pour parvenir à une adoption généralisée, il est nécessaire de réduire les coûts, d’améliorer la fiabilité des systèmes et de mettre en place des programmes de sensibilisation du public, qui doivent tous être adaptés à la culture. La mise en oeuvre de ces stratégies optimisera l’impact économique et environnemental des CES, facilitant ainsi le développement durable en Afrique de l’Ouest.
Abstract : West Africa, with its abundant solar potential, offers considerable prospects for the proliferation of solar water heaters (SWH). However, their usage remains limited due to economic, technical, and social barriers. This thesis undertakes a comprehensive socio-economic and experimental study of SWHs in arid and humid environments in West Africa. To achieve this objective, a methodology combining field surveys and case studies was adopted. Data were collected from various types of installations: an integrated collector storage SWH in a hospital laundry, a flat-plate collector SWH installed in a hotel and another in a household in Ouagadougou, as well as an evacuated-tube SWH in a household in Lomé. The performance of the systems was evaluated over a 12-month period, with specific measurements concerning energy efficiency, economic profitability, and the environmental impact of the systems. The data were supplemented by surveys on hot water consumption habits in the two cities and analyses of public policies and local social dynamics. The results reveal substantial regional variations: in Ouagadougou, 70% of households use LPG due to subsidies, while 9% adopt SWHs, compared to just 0.4% in Lomé, where charcoal is predominant. The performance of the SWHs also differs across the studied sites: in the hospital, the system generated 2,070 kWh, with an annual efficiency of 38% and a solar fraction of 17%. The SWH in the hotel produced an average of 770 kWh despite significant heat losses (30-50%), achieving a modest efficiency of 14-17%. In Lomé, a domestic SWH produced 1,055 kWh with an efficiency of 39%, while in Ouagadougou, the household consumed 1,313 kWh in a year, of which 1,243 kWh were provided by solar energy, achieving an average efficiency of 34%. The payback period varies between 2.4 and 10 years, depending on the installation, and SWHs reduce CO? emissions by 0.3 to 1.75 tonnes annually. Despite 80% user satisfaction, their adoption is hindered by high initial costs, technical failures (e.g., faulty floats), undersized systems, a lack of financing, and limited institutional coordination. Nevertheless, the outlook is promising due to substantial solar potential, the technological maturity of SWHs, favourable policies, and public-private partnerships. To achieve widespread adoption, it is necessary to lower costs, improve system reliability, and implement public awareness programmes, all tailored to the local culture. The implementation of these strategies will optimise the economic and environmental impact of SWHs, thereby facilitating sustainable development in West Africa. |
Thèse en Sciences et Technologies de l'Eau, de l'Energie et de l’Environnement. Analyse socio-économique et expérimentale des chauffe-eau solaires dans des régions arides et humides d’Afrique de l’Ouest [texte imprimé] / Claude Sara LEKOMBO . - 2025 . - 155 p. Langues : Français ( fre)
| Résumé : |
L’Afrique de l’Ouest, avec son potentiel solaire abondant, présente des perspectives considérables pour la prolifération des chauffe-eau solaires (CES). Cependant, leur utilisation reste limitée par des obstacles économiques, techniques et sociaux. Cette thèse entreprend une étude socio-économique et expérimentale complète des CES dans des environnements arides et humides. Pour atteindre cet objectif, une méthodologie combinant des enquêtes de terrain et des études de cas a été adoptée. Des données ont été collectées à partir de différents types d’installations : un CES autostockeur dans une buanderie d’hôpital, un CES à capteur plan installé dans un hôtel et un autre dans un ménage à Ouagadougou, ainsi qu’un CES à tubes sous-vide dans un ménage à Lomé. Les performances des systèmes ont été évaluées sur une période de 12 mois, avec des mesures spécifiques concernant l’efficacité énergétique, la rentabilité économique, et l’impact environnemental des systèmes. Les données ont été complétées par des enquêtes sur les habitudes de consommation d’eau chaude dans les deux villes et par des analyses des politiques publiques et des dynamiques sociales locales. Les résultats indiquent des variations substantielles entre les régions : à Ouagadougou, 70 % des ménages utilisent le gaz en raison des subventions, tandis que 9 % adoptent le CES, contre seulement 0,4 % à Lomé, où le charbon de bois prédomine. La performance des CES diffère également entre les sites étudiés : à l’hôpital, le système génère 2 070 kWh, avec un rendement annuel de 38 % et un taux de couverture de 17 %. Le CES a démontré une moyenne de 770 kWh à l’hôtel, malgré des pertes de chaleur significatives (30-50 %), atteignant un rendement modeste de 14 à 17 %. A Lomé, un CES domestique a produit 1 055 kWh avec un rendement de 39 %, tandis qu’à Ouagadougou, une famille a consommé 1 313 kWh en un an, dont 1 243 kWh ont été fournis par l’énergie solaire, atteignant un rendement moyen de 38 %. Le temps de retour sur investissement varie de 2,4 à 10 ans, selon l’installation, et les CES réduisent les émissions de CO? de 0,3 à 1,75 tonne par an. Malgré la satisfaction de 80 % des utilisateurs, leur adoption est entravée par des coûts initiaux élevés, des défaillances techniques (par exemple des flotteurs défectueux), des systèmes sous-dimensionnés, un manque de financement et une coordination institutionnelle limitée. Néanmoins, les perspectives sont encourageantes en raison du potentiel solaire substantiel, de la maturité technologique des CES, des politiques favorables et des partenariats public-privé. Pour parvenir à une adoption généralisée, il est nécessaire de réduire les coûts, d’améliorer la fiabilité des systèmes et de mettre en place des programmes de sensibilisation du public, qui doivent tous être adaptés à la culture. La mise en oeuvre de ces stratégies optimisera l’impact économique et environnemental des CES, facilitant ainsi le développement durable en Afrique de l’Ouest.
Abstract : West Africa, with its abundant solar potential, offers considerable prospects for the proliferation of solar water heaters (SWH). However, their usage remains limited due to economic, technical, and social barriers. This thesis undertakes a comprehensive socio-economic and experimental study of SWHs in arid and humid environments in West Africa. To achieve this objective, a methodology combining field surveys and case studies was adopted. Data were collected from various types of installations: an integrated collector storage SWH in a hospital laundry, a flat-plate collector SWH installed in a hotel and another in a household in Ouagadougou, as well as an evacuated-tube SWH in a household in Lomé. The performance of the systems was evaluated over a 12-month period, with specific measurements concerning energy efficiency, economic profitability, and the environmental impact of the systems. The data were supplemented by surveys on hot water consumption habits in the two cities and analyses of public policies and local social dynamics. The results reveal substantial regional variations: in Ouagadougou, 70% of households use LPG due to subsidies, while 9% adopt SWHs, compared to just 0.4% in Lomé, where charcoal is predominant. The performance of the SWHs also differs across the studied sites: in the hospital, the system generated 2,070 kWh, with an annual efficiency of 38% and a solar fraction of 17%. The SWH in the hotel produced an average of 770 kWh despite significant heat losses (30-50%), achieving a modest efficiency of 14-17%. In Lomé, a domestic SWH produced 1,055 kWh with an efficiency of 39%, while in Ouagadougou, the household consumed 1,313 kWh in a year, of which 1,243 kWh were provided by solar energy, achieving an average efficiency of 34%. The payback period varies between 2.4 and 10 years, depending on the installation, and SWHs reduce CO? emissions by 0.3 to 1.75 tonnes annually. Despite 80% user satisfaction, their adoption is hindered by high initial costs, technical failures (e.g., faulty floats), undersized systems, a lack of financing, and limited institutional coordination. Nevertheless, the outlook is promising due to substantial solar potential, the technological maturity of SWHs, favourable policies, and public-private partnerships. To achieve widespread adoption, it is necessary to lower costs, improve system reliability, and implement public awareness programmes, all tailored to the local culture. The implementation of these strategies will optimise the economic and environmental impact of SWHs, thereby facilitating sustainable development in West Africa. |
|  |


 Faire une suggestion Affiner la recherche
Faire une suggestion Affiner la rechercheThèse en Sciences et Technologies de l'Eau, de l'Energie et de l’Environnement. Analyse socio-économique et expérimentale des chauffe-eau solaires dans des régions arides et humides d’Afrique de l’Ouest / Claude Sara LEKOMBO