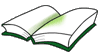Bienvenue au Centre de Documentation et d'Information de 2iE: Plus de 27422 ouvrages vous sont proposés
Détail de la série
Thèse en Sciences et Technologies de l'Eau, de l'Energie et de l’Environnement |
Documents disponibles dans cette série (79)

 Faire une suggestion Affiner la recherche
Faire une suggestion Affiner la rechercheThèse en Sciences et Technologies de l'Eau, de l'Energie et de l’Environnement. Analyse du cycle de vie des centrales photovoltaïques dans le contexte de pays en développement / Kodami BADZA

Titre de série : Thèse en Sciences et Technologies de l'Eau, de l'Energie et de l’Environnement Titre : Analyse du cycle de vie des centrales photovoltaïques dans le contexte de pays en développement : cas du Burkina Faso Type de document : texte imprimé Auteurs : Kodami BADZA, Auteur Année de publication : 2024 Importance : 207 p. Langues : Français (fre) Résumé : Les installations photovoltaïques connaissent une évolution croissante en Afrique subsaharienne à cause de la baisse continue de leurs coûts. Longtemps considérés comme une source d’énergie renouvelable, non polluante, les systèmes PV ne sont pas exempts d’impacts environnementaux. Bien que de nombreuses études dans le monde entier se soient concentrées sur leurs impacts environnementaux, très peu ont été menées en Afrique subsaharienne. L'objectif de cette thèse est d’évaluer les impacts environnementaux potentiels des centrales photovoltaïques dans le contexte des pays en voie de développement à travers des outils d’analyse du cycle de vie.
Tout d’abord, une étude d’évaluation des profils environnementaux et de comparaison des centrales PV de petite, moyenne et grande tailles entre elles d’une part, et avec celui le mix électrique du Burkina Faso d’autre part a été effectué. Pour cela, une approche du « berceau à la tombe » selon la norme ISO 14040 et ISO 14044 a été utilisée dans notre méthodologie. Le logiciel SimaPro 9.4 et la méthode d'évaluation ReCiPe 2016 Midpoint (H) ont été utilisés pour les calculs en considérant 09 indicateurs environnementaux. L’unité fonctionnelle considérée est « 1 kWh d’électricité produit par la centrale solaire photovoltaïque et injecté dans le réseau national pendant 25 ans ». Des analyses de sensibilité ont également été réalisées.
Les résultats de l'étude montrent que les profils environnementaux des centrales PV de grande et moyenne tailles sont dominés par la fabrication des modules (70-80%), la structure de montage (18-25%) et la fin de vie (30-45%) tandis que celui de la petite taille est dominé par l’étape de fabrication des batteries (34-97%). Il ressort également de l’étude comparative que les impacts environnementaux des centrales PV sont plus importants que ceux du mix électrique du Burkina Faso, excepté les indicateurs "le changement climatique" et "la consommation des ressources". La production de l’électricité par les centrales PV de grande et moyenne tailles présentent des avantages environnementaux substantiels de 50-99%/kWh que la centrale de petite taille dans toutes les catégories d’indicateurs, excepté l’occupation des sols où elles causent environ 70 fois plus d’impacts. L’utilisation des batteries plomb-acide par la centrale de petite taille est à l’origine de cette différence d’impact entre les centrales. Il ressort des analyses de sensibilité que le changement du pays de production des modules PV par un pays de mix électrique moins carboné engendre des réductions des impacts de 41-64%.
Une étude sur le système actuel de gestion des déchets PV au Burkina Faso a été menée. Des recherches documentaires, des entretiens, des questionnaires et des visites sur le terrain ont été utilisés dans la méthodologie. L'enquête a montré que la gestion des déchets PV était effectuée par le secteur informel et regroupait un ensemble d’acteurs tels que les collecteurs, les recycleurs, les réparateurs et les exportateurs. L’activité de gestion de ces déchets constitue une source d’émissions de plomb, des plastiques et des fumées néfastes pour la santé humaine et pour l’environnement. L’introduction d'une législation, la multiplication des points de collecte et des infrastructures appropriées, la formation et la sensibilisation des parties prenantes, et la responsabilité élargie des fabricants sont les mesures que nous avons recommandées pour réduire les impacts de la gestion actuelle des déchets PV.
Enfin, deux dernières études ont été menées : une étude sur les impacts environnementaux des différents scénarios de gestion de fin de vie des déchets PV et une autre sur la proposition de solutions pour minimiser les impacts environnementaux des centrales PV. La méthodologie d’analyse du cycle de vie et la méthode ReCiPe 2016 Endpoint (H) ont été utilisées pour évaluer les impacts environnementaux de quatre scénarios de gestion de déchets. Il ressort de cette étude que, comparés au scénario de gestion actuel des déchets PV, les scénarios de recyclage partiel ou total réduiraient les impacts environnementaux d’environ 30 à 90% en fonction de l’indicateur environnemental considéré. La réduction des impacts environnementaux passe aussi par un certain nombre de choix, tels que la technologie des modules PV utilisés et leur lieu de production, le choix du type de montage, le lieu d’installation de la centrale PV et sa gestion de fin de vie.
Abstract : Photovoltaic (PV) installations are growing in popularity in sub Saharan Africa as costs continue to decline . Long time considered a s a renewable energy , non polluting energy source , PV systems are not exempt from environmental impacts. Although numerous studies worldwide have focused on their environmental impacts, very few have been conducted in sub Saharan Africa. Th is thesis aim s to assess the potential environmental impacts of photovoltaic power plants in the context of developing countries, using the life cycle assessment tool. First, a study was carried out to assess the environmental profiles and compare small, medium and large scale PV power plants between themselves, on the one hand, and with the electricity mix in Burkina Faso , on the other hand . A "cradle to grave" approach, according to the standards ISO 14040 and ISO 14044, was used . SimaPro 9.4 software and the ReCiPe 2016 Midpoint (H) evaluation method were used for the calculations, considering 09 environmental indicators. The functional unit considered is "1 kWh of electricity produced by the solar photovoltaic plant and fed into the national grid for 25 years". Sensitivity analyses were also carried out.The results of the study show that the environmental profiles of large and medium sized PV power plants are dominated by the module manufacturing stage (70 80%), the mounting structure (18 25%) and the end of life stage (30 45%), while that of small PV power plants is dominated by the battery manufacturing stage (34 97%). The comparative study also shows that the environmental impacts of PV power plants are greater than those of Burkina Faso's electricity mix, except for climate change and resource consumption indicators . Electricity generation by large and medium sized PV power plants has substantial environmental advantages of 50 99%/kWh over small scale PV power plants in all indicator categories except land use, wh ich causes around 70 times more impact s . The use of lead acid batteries in the smaller PV plant is responsible for this difference in impact between the plants. Sensitivity analyses show that changing the country of PV module manufacturing to a less carbon intensive electricity mix one results in impact reductions of 41 64%. Next, a study of the current PV waste management system in Burkina Faso was carried out. Documentary research, interviews, questionnaires, and field visits were used in the methodology. The survey showed that PV waste management was carried out by the informal sector, involving a range of stakeholders such as collectors, recyclers, repairers, and exporters. This waste management activity is a source of lead emissions, plastics, and fumes harmful to human health and the environment. The introduction of legislation, the multiplication of human health and the environment. The introduction of legislation, the multiplication of collection points and appropriate infrastructures, the training and awarenesscollection points and appropriate infrastructures, the training and awareness raising of raising of stakeholders, and the extended responsibility of manufacturers arestakeholders, and the extended responsibility of manufacturers are thethe measures measures we we recommend to reduce the impactrecommend to reduce the impactss of current PV waste management.of current PV waste management. Two final studies were carried out: one on the environmental impact of different end--ofof--life management scenarios for PV waste, and another on proposed solutions for minimizing life management scenarios for PV waste, and another on proposed solutions for minimizing the environmental impact of PV power plants.the environmental impact of PV power plants. The life cycle assessment methodology and the The life cycle assessment methodology and the ReCiPe 2016 Endpoint (H) method were used to assess the environmental impacts of four ReCiPe 2016 Endpoint (H) method were used to assess the environmental impacts of four waste management scenarios. The study showed that, compared with the current PV waste waste management scenarios. The study showed that, compared with the current PV waste management scenario, partial or total recycling scenarios would reduce environmental management scenario, partial or total recycling scenarios would reduce environmental impacts by around 30% impacts by around 30% up up to 90%, depending on the environmental indicator considered. to 90%, depending on the environmental indicator considered. Reducing environmental impacts involves Reducing environmental impacts involves somesome choices, such as the technology of the PV choices, such as the technology of the PV modules used and modules used and where they are where they are manufactured,manufactured, the choice of mountingthe choice of mounting structurestructure, the , the locationlocation of of the PV plants,the PV plants, and and his his endend--ofof--life management.life management.
Thèse en Sciences et Technologies de l'Eau, de l'Energie et de l’Environnement. Analyse du cycle de vie des centrales photovoltaïques dans le contexte de pays en développement : cas du Burkina Faso [texte imprimé] / Kodami BADZA, Auteur . - 2024 . - 207 p.
Langues : Français (fre)
Résumé : Les installations photovoltaïques connaissent une évolution croissante en Afrique subsaharienne à cause de la baisse continue de leurs coûts. Longtemps considérés comme une source d’énergie renouvelable, non polluante, les systèmes PV ne sont pas exempts d’impacts environnementaux. Bien que de nombreuses études dans le monde entier se soient concentrées sur leurs impacts environnementaux, très peu ont été menées en Afrique subsaharienne. L'objectif de cette thèse est d’évaluer les impacts environnementaux potentiels des centrales photovoltaïques dans le contexte des pays en voie de développement à travers des outils d’analyse du cycle de vie.
Tout d’abord, une étude d’évaluation des profils environnementaux et de comparaison des centrales PV de petite, moyenne et grande tailles entre elles d’une part, et avec celui le mix électrique du Burkina Faso d’autre part a été effectué. Pour cela, une approche du « berceau à la tombe » selon la norme ISO 14040 et ISO 14044 a été utilisée dans notre méthodologie. Le logiciel SimaPro 9.4 et la méthode d'évaluation ReCiPe 2016 Midpoint (H) ont été utilisés pour les calculs en considérant 09 indicateurs environnementaux. L’unité fonctionnelle considérée est « 1 kWh d’électricité produit par la centrale solaire photovoltaïque et injecté dans le réseau national pendant 25 ans ». Des analyses de sensibilité ont également été réalisées.
Les résultats de l'étude montrent que les profils environnementaux des centrales PV de grande et moyenne tailles sont dominés par la fabrication des modules (70-80%), la structure de montage (18-25%) et la fin de vie (30-45%) tandis que celui de la petite taille est dominé par l’étape de fabrication des batteries (34-97%). Il ressort également de l’étude comparative que les impacts environnementaux des centrales PV sont plus importants que ceux du mix électrique du Burkina Faso, excepté les indicateurs "le changement climatique" et "la consommation des ressources". La production de l’électricité par les centrales PV de grande et moyenne tailles présentent des avantages environnementaux substantiels de 50-99%/kWh que la centrale de petite taille dans toutes les catégories d’indicateurs, excepté l’occupation des sols où elles causent environ 70 fois plus d’impacts. L’utilisation des batteries plomb-acide par la centrale de petite taille est à l’origine de cette différence d’impact entre les centrales. Il ressort des analyses de sensibilité que le changement du pays de production des modules PV par un pays de mix électrique moins carboné engendre des réductions des impacts de 41-64%.
Une étude sur le système actuel de gestion des déchets PV au Burkina Faso a été menée. Des recherches documentaires, des entretiens, des questionnaires et des visites sur le terrain ont été utilisés dans la méthodologie. L'enquête a montré que la gestion des déchets PV était effectuée par le secteur informel et regroupait un ensemble d’acteurs tels que les collecteurs, les recycleurs, les réparateurs et les exportateurs. L’activité de gestion de ces déchets constitue une source d’émissions de plomb, des plastiques et des fumées néfastes pour la santé humaine et pour l’environnement. L’introduction d'une législation, la multiplication des points de collecte et des infrastructures appropriées, la formation et la sensibilisation des parties prenantes, et la responsabilité élargie des fabricants sont les mesures que nous avons recommandées pour réduire les impacts de la gestion actuelle des déchets PV.
Enfin, deux dernières études ont été menées : une étude sur les impacts environnementaux des différents scénarios de gestion de fin de vie des déchets PV et une autre sur la proposition de solutions pour minimiser les impacts environnementaux des centrales PV. La méthodologie d’analyse du cycle de vie et la méthode ReCiPe 2016 Endpoint (H) ont été utilisées pour évaluer les impacts environnementaux de quatre scénarios de gestion de déchets. Il ressort de cette étude que, comparés au scénario de gestion actuel des déchets PV, les scénarios de recyclage partiel ou total réduiraient les impacts environnementaux d’environ 30 à 90% en fonction de l’indicateur environnemental considéré. La réduction des impacts environnementaux passe aussi par un certain nombre de choix, tels que la technologie des modules PV utilisés et leur lieu de production, le choix du type de montage, le lieu d’installation de la centrale PV et sa gestion de fin de vie.
Abstract : Photovoltaic (PV) installations are growing in popularity in sub Saharan Africa as costs continue to decline . Long time considered a s a renewable energy , non polluting energy source , PV systems are not exempt from environmental impacts. Although numerous studies worldwide have focused on their environmental impacts, very few have been conducted in sub Saharan Africa. Th is thesis aim s to assess the potential environmental impacts of photovoltaic power plants in the context of developing countries, using the life cycle assessment tool. First, a study was carried out to assess the environmental profiles and compare small, medium and large scale PV power plants between themselves, on the one hand, and with the electricity mix in Burkina Faso , on the other hand . A "cradle to grave" approach, according to the standards ISO 14040 and ISO 14044, was used . SimaPro 9.4 software and the ReCiPe 2016 Midpoint (H) evaluation method were used for the calculations, considering 09 environmental indicators. The functional unit considered is "1 kWh of electricity produced by the solar photovoltaic plant and fed into the national grid for 25 years". Sensitivity analyses were also carried out.The results of the study show that the environmental profiles of large and medium sized PV power plants are dominated by the module manufacturing stage (70 80%), the mounting structure (18 25%) and the end of life stage (30 45%), while that of small PV power plants is dominated by the battery manufacturing stage (34 97%). The comparative study also shows that the environmental impacts of PV power plants are greater than those of Burkina Faso's electricity mix, except for climate change and resource consumption indicators . Electricity generation by large and medium sized PV power plants has substantial environmental advantages of 50 99%/kWh over small scale PV power plants in all indicator categories except land use, wh ich causes around 70 times more impact s . The use of lead acid batteries in the smaller PV plant is responsible for this difference in impact between the plants. Sensitivity analyses show that changing the country of PV module manufacturing to a less carbon intensive electricity mix one results in impact reductions of 41 64%. Next, a study of the current PV waste management system in Burkina Faso was carried out. Documentary research, interviews, questionnaires, and field visits were used in the methodology. The survey showed that PV waste management was carried out by the informal sector, involving a range of stakeholders such as collectors, recyclers, repairers, and exporters. This waste management activity is a source of lead emissions, plastics, and fumes harmful to human health and the environment. The introduction of legislation, the multiplication of human health and the environment. The introduction of legislation, the multiplication of collection points and appropriate infrastructures, the training and awarenesscollection points and appropriate infrastructures, the training and awareness raising of raising of stakeholders, and the extended responsibility of manufacturers arestakeholders, and the extended responsibility of manufacturers are thethe measures measures we we recommend to reduce the impactrecommend to reduce the impactss of current PV waste management.of current PV waste management. Two final studies were carried out: one on the environmental impact of different end--ofof--life management scenarios for PV waste, and another on proposed solutions for minimizing life management scenarios for PV waste, and another on proposed solutions for minimizing the environmental impact of PV power plants.the environmental impact of PV power plants. The life cycle assessment methodology and the The life cycle assessment methodology and the ReCiPe 2016 Endpoint (H) method were used to assess the environmental impacts of four ReCiPe 2016 Endpoint (H) method were used to assess the environmental impacts of four waste management scenarios. The study showed that, compared with the current PV waste waste management scenarios. The study showed that, compared with the current PV waste management scenario, partial or total recycling scenarios would reduce environmental management scenario, partial or total recycling scenarios would reduce environmental impacts by around 30% impacts by around 30% up up to 90%, depending on the environmental indicator considered. to 90%, depending on the environmental indicator considered. Reducing environmental impacts involves Reducing environmental impacts involves somesome choices, such as the technology of the PV choices, such as the technology of the PV modules used and modules used and where they are where they are manufactured,manufactured, the choice of mountingthe choice of mounting structurestructure, the , the locationlocation of of the PV plants,the PV plants, and and his his endend--ofof--life management.life management.
Exemplaires(0)
Disponibilité aucun exemplaire Documents numériques

BadzaAdobe Acrobat PDFThèse en Sciences et Technologies de l'Eau, de l'Energie et de l’Environnement. Analyse et optimisation de la durabilité des systèmes de production de biocarburants oléagineux en Afrique de l’Ouest / Linda Dominique Fabiola BAMBARA

Titre de série : Thèse en Sciences et Technologies de l'Eau, de l'Energie et de l’Environnement Titre : Analyse et optimisation de la durabilité des systèmes de production de biocarburants oléagineux en Afrique de l’Ouest Type de document : texte imprimé Auteurs : Linda Dominique Fabiola BAMBARA Année de publication : 2018 Importance : 144 p. Langues : Français (fre) Résumé : La durabilité des filières de production de biocarburants oléagineux est une condition indispensable à leur compétitivité par rapport aux carburants d’origine fossile. Cette durabilité dépend de plusieurs facteurs intrinsèques liés aux technologies de transformation, au choix des matières premières adéquates, à l’organisation de ces filières et à la valorisation des coproduits.
Le constat est que malgré l’essor des biocarburants depuis les années 2000 dans le monde et en Afrique, l’approvisionnement des unités de transformation de biomasse oléagineuse en biocarburant n’a pas été suffisamment étudié dans le contexte africain.
De plus, les différents processus de ces filières que sont : la production de la biomasse, la logistique d’approvisionnement et la conversion de la biomasse en vecteur énergétique, ainsi que la valorisation des coproduits sont abordés séparément dans la littérature.
Dans un tel contexte, une prise en compte intégrée de ces différents processus permettra d’avoir une vision plus globale de l’imputation des coûts et des impacts générés à chaque étape de la chaîne logistique en vue de rendre durable les filières de production de biocarburant oléagineux.
Cette étude a donc pour objectif d’évaluer et d’optimiser les conditions de durabilité des filières de production de biocarburants en Afrique de l’Ouest. L’approche méthodologique a consisté à déterminer pour deux biomasses oléagineuses que sont le Jatropha, et le Balanites, les paramètres et variables qui caractérisent les processus de la chaîne logistique et la valorisation des sous-produits et ensuite à concevoir un modèle d’optimisation des filières de biocarburants oléagineux et un système d’aide à la décision pour les acteurs du domaine.
Abstract : The sustainability of oilseed-based biofuel production chains is a prerequisite for their competitiveness in relation to fossil fuels. This sustainability depends on several intrinsic factors related to processing technologies, the choice of appropriate feedstock, and the configuration of the supply chain and the reuse of by-products.
Despite the great interest in biofuels since the 2000s in the world and in Africa, the observation was that the supply of oilseed biomass to biofuel production units has not been sufficiently studied in the African context. In addition, the different processes, such as biomass production, supply logistics and the conversion of biomass into biofuels, as well as the reuse of by-products, are addressed separately in the literature.
In such a context, an integrated consideration of these different processes will allow a more global vision of the allocation of costs and impacts generated at each stage of the supply chain.
This study therefore aims to evaluate and optimize the sustainability conditions of biofuel production chains in West Africa. The methodological approach was to determine for two oilseed biomass, Jatropha and Balanites, the parameters and variables that characterize the processes of the supply chain and the reuse of the by-products and then, to develop an optimization model for biomass supply and a decision-making tool for the biofuel production stakeholders.Thèse en Sciences et Technologies de l'Eau, de l'Energie et de l’Environnement. Analyse et optimisation de la durabilité des systèmes de production de biocarburants oléagineux en Afrique de l’Ouest [texte imprimé] / Linda Dominique Fabiola BAMBARA . - 2018 . - 144 p.
Langues : Français (fre)
Résumé : La durabilité des filières de production de biocarburants oléagineux est une condition indispensable à leur compétitivité par rapport aux carburants d’origine fossile. Cette durabilité dépend de plusieurs facteurs intrinsèques liés aux technologies de transformation, au choix des matières premières adéquates, à l’organisation de ces filières et à la valorisation des coproduits.
Le constat est que malgré l’essor des biocarburants depuis les années 2000 dans le monde et en Afrique, l’approvisionnement des unités de transformation de biomasse oléagineuse en biocarburant n’a pas été suffisamment étudié dans le contexte africain.
De plus, les différents processus de ces filières que sont : la production de la biomasse, la logistique d’approvisionnement et la conversion de la biomasse en vecteur énergétique, ainsi que la valorisation des coproduits sont abordés séparément dans la littérature.
Dans un tel contexte, une prise en compte intégrée de ces différents processus permettra d’avoir une vision plus globale de l’imputation des coûts et des impacts générés à chaque étape de la chaîne logistique en vue de rendre durable les filières de production de biocarburant oléagineux.
Cette étude a donc pour objectif d’évaluer et d’optimiser les conditions de durabilité des filières de production de biocarburants en Afrique de l’Ouest. L’approche méthodologique a consisté à déterminer pour deux biomasses oléagineuses que sont le Jatropha, et le Balanites, les paramètres et variables qui caractérisent les processus de la chaîne logistique et la valorisation des sous-produits et ensuite à concevoir un modèle d’optimisation des filières de biocarburants oléagineux et un système d’aide à la décision pour les acteurs du domaine.
Abstract : The sustainability of oilseed-based biofuel production chains is a prerequisite for their competitiveness in relation to fossil fuels. This sustainability depends on several intrinsic factors related to processing technologies, the choice of appropriate feedstock, and the configuration of the supply chain and the reuse of by-products.
Despite the great interest in biofuels since the 2000s in the world and in Africa, the observation was that the supply of oilseed biomass to biofuel production units has not been sufficiently studied in the African context. In addition, the different processes, such as biomass production, supply logistics and the conversion of biomass into biofuels, as well as the reuse of by-products, are addressed separately in the literature.
In such a context, an integrated consideration of these different processes will allow a more global vision of the allocation of costs and impacts generated at each stage of the supply chain.
This study therefore aims to evaluate and optimize the sustainability conditions of biofuel production chains in West Africa. The methodological approach was to determine for two oilseed biomass, Jatropha and Balanites, the parameters and variables that characterize the processes of the supply chain and the reuse of the by-products and then, to develop an optimization model for biomass supply and a decision-making tool for the biofuel production stakeholders.Exemplaires(0)
Disponibilité aucun exemplaire Documents numériques

LindaAdobe Acrobat PDFThèse en Sciences et Technologies de l'Eau, de l'Energie et de l’Environnement. Analyse socio-économique et expérimentale des chauffe-eau solaires dans des régions arides et humides d’Afrique de l’Ouest / Claude Sara LEKOMBO

Titre de série : Thèse en Sciences et Technologies de l'Eau, de l'Energie et de l’Environnement Titre : Analyse socio-économique et expérimentale des chauffe-eau solaires dans des régions arides et humides d’Afrique de l’Ouest Type de document : texte imprimé Auteurs : Claude Sara LEKOMBO Année de publication : 2025 Importance : 155 p. Langues : Français (fre) Résumé : L’Afrique de l’Ouest, avec son potentiel solaire abondant, présente des perspectives considérables pour la prolifération des chauffe-eau solaires (CES). Cependant, leur utilisation reste limitée par des obstacles économiques, techniques et sociaux. Cette thèse entreprend une étude socio-économique et expérimentale complète des CES dans des environnements arides et humides. Pour atteindre cet objectif, une méthodologie combinant des enquêtes de terrain et des études de cas a été adoptée. Des données ont été collectées à partir de différents types d’installations : un CES autostockeur dans une buanderie d’hôpital, un CES à capteur plan installé dans un hôtel et un autre dans un ménage à Ouagadougou, ainsi qu’un CES à tubes sous-vide dans un ménage à Lomé. Les performances des systèmes ont été évaluées sur une période de 12 mois, avec des mesures spécifiques concernant l’efficacité énergétique, la rentabilité économique, et l’impact environnemental des systèmes. Les données ont été complétées par des enquêtes sur les habitudes de consommation d’eau chaude dans les deux villes et par des analyses des politiques publiques et des dynamiques sociales locales. Les résultats indiquent des variations substantielles entre les régions : à Ouagadougou, 70 % des ménages utilisent le gaz en raison des subventions, tandis que 9 % adoptent le CES, contre seulement 0,4 % à Lomé, où le charbon de bois prédomine. La performance des CES diffère également entre les sites étudiés : à l’hôpital, le système génère 2 070 kWh, avec un rendement annuel de 38 % et un taux de couverture de 17 %. Le CES a démontré une moyenne de 770 kWh à l’hôtel, malgré des pertes de chaleur significatives (30-50 %), atteignant un rendement modeste de 14 à 17 %. A Lomé, un CES domestique a produit 1 055 kWh avec un rendement de 39 %, tandis qu’à Ouagadougou, une famille a consommé 1 313 kWh en un an, dont 1 243 kWh ont été fournis par l’énergie solaire, atteignant un rendement moyen de 38 %. Le temps de retour sur investissement varie de 2,4 à 10 ans, selon l’installation, et les CES réduisent les émissions de CO? de 0,3 à 1,75 tonne par an. Malgré la satisfaction de 80 % des utilisateurs, leur adoption est entravée par des coûts initiaux élevés, des défaillances techniques (par exemple des flotteurs défectueux), des systèmes sous-dimensionnés, un manque de financement et une coordination institutionnelle limitée. Néanmoins, les perspectives sont encourageantes en raison du potentiel solaire substantiel, de la maturité technologique des CES, des politiques favorables et des partenariats public-privé. Pour parvenir à une adoption généralisée, il est nécessaire de réduire les coûts, d’améliorer la fiabilité des systèmes et de mettre en place des programmes de sensibilisation du public, qui doivent tous être adaptés à la culture. La mise en oeuvre de ces stratégies optimisera l’impact économique et environnemental des CES, facilitant ainsi le développement durable en Afrique de l’Ouest.
Abstract : West Africa, with its abundant solar potential, offers considerable prospects for the proliferation of solar water heaters (SWH). However, their usage remains limited due to economic, technical, and social barriers. This thesis undertakes a comprehensive socio-economic and experimental study of SWHs in arid and humid environments in West Africa. To achieve this objective, a methodology combining field surveys and case studies was adopted. Data were collected from various types of installations: an integrated collector storage SWH in a hospital laundry, a flat-plate collector SWH installed in a hotel and another in a household in Ouagadougou, as well as an evacuated-tube SWH in a household in Lomé. The performance of the systems was evaluated over a 12-month period, with specific measurements concerning energy efficiency, economic profitability, and the environmental impact of the systems. The data were supplemented by surveys on hot water consumption habits in the two cities and analyses of public policies and local social dynamics. The results reveal substantial regional variations: in Ouagadougou, 70% of households use LPG due to subsidies, while 9% adopt SWHs, compared to just 0.4% in Lomé, where charcoal is predominant. The performance of the SWHs also differs across the studied sites: in the hospital, the system generated 2,070 kWh, with an annual efficiency of 38% and a solar fraction of 17%. The SWH in the hotel produced an average of 770 kWh despite significant heat losses (30-50%), achieving a modest efficiency of 14-17%. In Lomé, a domestic SWH produced 1,055 kWh with an efficiency of 39%, while in Ouagadougou, the household consumed 1,313 kWh in a year, of which 1,243 kWh were provided by solar energy, achieving an average efficiency of 34%. The payback period varies between 2.4 and 10 years, depending on the installation, and SWHs reduce CO? emissions by 0.3 to 1.75 tonnes annually. Despite 80% user satisfaction, their adoption is hindered by high initial costs, technical failures (e.g., faulty floats), undersized systems, a lack of financing, and limited institutional coordination. Nevertheless, the outlook is promising due to substantial solar potential, the technological maturity of SWHs, favourable policies, and public-private partnerships. To achieve widespread adoption, it is necessary to lower costs, improve system reliability, and implement public awareness programmes, all tailored to the local culture. The implementation of these strategies will optimise the economic and environmental impact of SWHs, thereby facilitating sustainable development in West Africa.
Thèse en Sciences et Technologies de l'Eau, de l'Energie et de l’Environnement. Analyse socio-économique et expérimentale des chauffe-eau solaires dans des régions arides et humides d’Afrique de l’Ouest [texte imprimé] / Claude Sara LEKOMBO . - 2025 . - 155 p.
Langues : Français (fre)
Résumé : L’Afrique de l’Ouest, avec son potentiel solaire abondant, présente des perspectives considérables pour la prolifération des chauffe-eau solaires (CES). Cependant, leur utilisation reste limitée par des obstacles économiques, techniques et sociaux. Cette thèse entreprend une étude socio-économique et expérimentale complète des CES dans des environnements arides et humides. Pour atteindre cet objectif, une méthodologie combinant des enquêtes de terrain et des études de cas a été adoptée. Des données ont été collectées à partir de différents types d’installations : un CES autostockeur dans une buanderie d’hôpital, un CES à capteur plan installé dans un hôtel et un autre dans un ménage à Ouagadougou, ainsi qu’un CES à tubes sous-vide dans un ménage à Lomé. Les performances des systèmes ont été évaluées sur une période de 12 mois, avec des mesures spécifiques concernant l’efficacité énergétique, la rentabilité économique, et l’impact environnemental des systèmes. Les données ont été complétées par des enquêtes sur les habitudes de consommation d’eau chaude dans les deux villes et par des analyses des politiques publiques et des dynamiques sociales locales. Les résultats indiquent des variations substantielles entre les régions : à Ouagadougou, 70 % des ménages utilisent le gaz en raison des subventions, tandis que 9 % adoptent le CES, contre seulement 0,4 % à Lomé, où le charbon de bois prédomine. La performance des CES diffère également entre les sites étudiés : à l’hôpital, le système génère 2 070 kWh, avec un rendement annuel de 38 % et un taux de couverture de 17 %. Le CES a démontré une moyenne de 770 kWh à l’hôtel, malgré des pertes de chaleur significatives (30-50 %), atteignant un rendement modeste de 14 à 17 %. A Lomé, un CES domestique a produit 1 055 kWh avec un rendement de 39 %, tandis qu’à Ouagadougou, une famille a consommé 1 313 kWh en un an, dont 1 243 kWh ont été fournis par l’énergie solaire, atteignant un rendement moyen de 38 %. Le temps de retour sur investissement varie de 2,4 à 10 ans, selon l’installation, et les CES réduisent les émissions de CO? de 0,3 à 1,75 tonne par an. Malgré la satisfaction de 80 % des utilisateurs, leur adoption est entravée par des coûts initiaux élevés, des défaillances techniques (par exemple des flotteurs défectueux), des systèmes sous-dimensionnés, un manque de financement et une coordination institutionnelle limitée. Néanmoins, les perspectives sont encourageantes en raison du potentiel solaire substantiel, de la maturité technologique des CES, des politiques favorables et des partenariats public-privé. Pour parvenir à une adoption généralisée, il est nécessaire de réduire les coûts, d’améliorer la fiabilité des systèmes et de mettre en place des programmes de sensibilisation du public, qui doivent tous être adaptés à la culture. La mise en oeuvre de ces stratégies optimisera l’impact économique et environnemental des CES, facilitant ainsi le développement durable en Afrique de l’Ouest.
Abstract : West Africa, with its abundant solar potential, offers considerable prospects for the proliferation of solar water heaters (SWH). However, their usage remains limited due to economic, technical, and social barriers. This thesis undertakes a comprehensive socio-economic and experimental study of SWHs in arid and humid environments in West Africa. To achieve this objective, a methodology combining field surveys and case studies was adopted. Data were collected from various types of installations: an integrated collector storage SWH in a hospital laundry, a flat-plate collector SWH installed in a hotel and another in a household in Ouagadougou, as well as an evacuated-tube SWH in a household in Lomé. The performance of the systems was evaluated over a 12-month period, with specific measurements concerning energy efficiency, economic profitability, and the environmental impact of the systems. The data were supplemented by surveys on hot water consumption habits in the two cities and analyses of public policies and local social dynamics. The results reveal substantial regional variations: in Ouagadougou, 70% of households use LPG due to subsidies, while 9% adopt SWHs, compared to just 0.4% in Lomé, where charcoal is predominant. The performance of the SWHs also differs across the studied sites: in the hospital, the system generated 2,070 kWh, with an annual efficiency of 38% and a solar fraction of 17%. The SWH in the hotel produced an average of 770 kWh despite significant heat losses (30-50%), achieving a modest efficiency of 14-17%. In Lomé, a domestic SWH produced 1,055 kWh with an efficiency of 39%, while in Ouagadougou, the household consumed 1,313 kWh in a year, of which 1,243 kWh were provided by solar energy, achieving an average efficiency of 34%. The payback period varies between 2.4 and 10 years, depending on the installation, and SWHs reduce CO? emissions by 0.3 to 1.75 tonnes annually. Despite 80% user satisfaction, their adoption is hindered by high initial costs, technical failures (e.g., faulty floats), undersized systems, a lack of financing, and limited institutional coordination. Nevertheless, the outlook is promising due to substantial solar potential, the technological maturity of SWHs, favourable policies, and public-private partnerships. To achieve widespread adoption, it is necessary to lower costs, improve system reliability, and implement public awareness programmes, all tailored to the local culture. The implementation of these strategies will optimise the economic and environmental impact of SWHs, thereby facilitating sustainable development in West Africa.
Exemplaires(0)
Disponibilité aucun exemplaire Documents numériques

Manuscrit_LEKOMBO_CLAUDE_SARAAdobe Acrobat PDFThèse en Sciences et Technologies de l'Eau, de l'Energie et de l’Environnement. Analyse spatio-temporelle des facteurs environnementaux et socio-sanitaires favorables à la persistance des maladies liées à l’eau / Frédéric Ragnanguénéwindé COMPAORE

Titre de série : Thèse en Sciences et Technologies de l'Eau, de l'Energie et de l’Environnement Titre : Analyse spatio-temporelle des facteurs environnementaux et socio-sanitaires favorables à la persistance des maladies liées à l’eau : cas de la schistosomiase au Burkina Faso Type de document : texte imprimé Auteurs : Frédéric Ragnanguénéwindé COMPAORE Année de publication : 2018 Importance : 148 p. Langues : Français (fre) Résumé : La schistosomiase est une parasitose infectieuse liée à l’eau à caractère focal provoquée par un ver parasite du genre schistosoma. Elle sévit en zones tropicales et subtropicales et appartient à la catégorie des maladies tropicales négligées (MTN). Cette pathologie représente dans les pays en développement et plus particulièrement au Burkina Faso, un problème grave
de santé publique. Les graves conséquences notamment en termes socio-économiques au Burkina ont conduit à la mise en place en 2004 d’un programme national de lutte dont la stratégie est le traitement de masse des enfants d’âge scolaire et des communautés à haut risque dans 22 sites sentinelles avec du praziquantel. Malgré cette décennie de traitement, une
persistance avec des prévalences et des densités d’infection importantes est toujours observée.
Cette étude a pour objectif d’étudier les facteurs explicatifs de la persistance de cette parasitose. Elle est basée sur une approche intégrée combinant les trois aspects social, environnemental et sanitaire. Au plan social, l’étude vise à démontrer les facteurs sociaux pertinents de la persistance à travers une enquête socio-anthropologique suivie d’un diagnostic sanitaire ; une analyse multivariée notamment une régression logistique binaire a permis d’établir le modèle de transmission de la maladie en identifiant les facteurs sociaux pertinents associés à son occurrence sur le site. Au plan environnemental, il s’agit d’identifier la saison de forte incidence à travers un suivi saisonnier des paramètres du cycle de transmission. Au plan sanitaire, il s’agit d’évaluer la stratégie de traitement de masse et les techniques et méthodes de diagnostic utilisées. Cette étude a permis de comprendre que les facteurs sociaux majeurs associés à la maladie sont la position des ménages donc des individus par rapport au point d’eau, la défécation à l’air libre, l’âge et les contacts avec l’eau. Par ailleurs, elle a permis d’identifier la saison chaude (Mars - Avril) comme la saison de forte incidence, autrement dit les campagnes de traitement de masse seraient plus efficaces en début de saison hivernale. Enfin, l’étude a démontré que la stratégie de traitement n’assurait pas de doses optimales de praziquantel pourtant recommandées dans des zones endémiques comme Panamasso. A n’en pas douter, cette étude contribue considérablement à une meilleure orientation de la stratégie de lutte contre cette pathologie débilitante qui freine le développement du Burkina Faso en handicapant sa ressource humaine.
Abstract : Schistosomiasis is a water related infectious parasitosis with focal specificity caused by a worm of the genus Schistosoma. As a Neglected Tropical Disease (NTD), it severely acts in tropical and subtropical zones. This pathology represents in developing countries particularly in Burkina Faso, a public health problem of major concern. The important inconveniences notably in socio-economic terms in Burkina Faso lead to the establishment of a national fight program whose strategy is based on mass drug administration for school-aged children and high risk communities in 22 sentinel sites with praziquantel. Despite this decade of treatment, persistence with high prevalence and densities is always observed. This study aims at studying the explanatory factors of the disease. It is based on an integrated approach combining social, environmental and sanitary aspects. Regarding social aspects, this study aims at demonstrating the relevant associated factors to the disease through a socio ? anthropological survey followed by sanitary diagnostic. A multivariate analysis especially binary logistic regression was used to establish the disease transmission model by identifying the important factors associated to its occurrence. With regard to environmental aspects, the study goal is to identify the season of high incidence through a monitoring of transmission cycle parameters. As for sanitary aspects; the purpose is to evaluate the mass drug administration strategy, the diagnostic technic and method used currently. This study demonstrated that the major factors associated to the disease are the geographic position of the household then of individuals relatively to the river, the lack of sanitation i.e. opens defecation, age and contacts with water. Besides, this study allowed the identification of the warm season (March ? April) as the one of high incidence, in other words, the mass drug administration campaigns would be more efficacy at the start of the rainy season. At last, the study revealed that the treatment strategy do not assure optimal praziquantel doses whereas these doses are recommended on endemic sites such as Panamasso. Undoubtedly, this study contributes considerably to a best orientation of the fight strategy against this debilitating disease that hampers the development of Burkina Faso by handicapping its human resource.Thèse en Sciences et Technologies de l'Eau, de l'Energie et de l’Environnement. Analyse spatio-temporelle des facteurs environnementaux et socio-sanitaires favorables à la persistance des maladies liées à l’eau : cas de la schistosomiase au Burkina Faso [texte imprimé] / Frédéric Ragnanguénéwindé COMPAORE . - 2018 . - 148 p.
Langues : Français (fre)
Résumé : La schistosomiase est une parasitose infectieuse liée à l’eau à caractère focal provoquée par un ver parasite du genre schistosoma. Elle sévit en zones tropicales et subtropicales et appartient à la catégorie des maladies tropicales négligées (MTN). Cette pathologie représente dans les pays en développement et plus particulièrement au Burkina Faso, un problème grave
de santé publique. Les graves conséquences notamment en termes socio-économiques au Burkina ont conduit à la mise en place en 2004 d’un programme national de lutte dont la stratégie est le traitement de masse des enfants d’âge scolaire et des communautés à haut risque dans 22 sites sentinelles avec du praziquantel. Malgré cette décennie de traitement, une
persistance avec des prévalences et des densités d’infection importantes est toujours observée.
Cette étude a pour objectif d’étudier les facteurs explicatifs de la persistance de cette parasitose. Elle est basée sur une approche intégrée combinant les trois aspects social, environnemental et sanitaire. Au plan social, l’étude vise à démontrer les facteurs sociaux pertinents de la persistance à travers une enquête socio-anthropologique suivie d’un diagnostic sanitaire ; une analyse multivariée notamment une régression logistique binaire a permis d’établir le modèle de transmission de la maladie en identifiant les facteurs sociaux pertinents associés à son occurrence sur le site. Au plan environnemental, il s’agit d’identifier la saison de forte incidence à travers un suivi saisonnier des paramètres du cycle de transmission. Au plan sanitaire, il s’agit d’évaluer la stratégie de traitement de masse et les techniques et méthodes de diagnostic utilisées. Cette étude a permis de comprendre que les facteurs sociaux majeurs associés à la maladie sont la position des ménages donc des individus par rapport au point d’eau, la défécation à l’air libre, l’âge et les contacts avec l’eau. Par ailleurs, elle a permis d’identifier la saison chaude (Mars - Avril) comme la saison de forte incidence, autrement dit les campagnes de traitement de masse seraient plus efficaces en début de saison hivernale. Enfin, l’étude a démontré que la stratégie de traitement n’assurait pas de doses optimales de praziquantel pourtant recommandées dans des zones endémiques comme Panamasso. A n’en pas douter, cette étude contribue considérablement à une meilleure orientation de la stratégie de lutte contre cette pathologie débilitante qui freine le développement du Burkina Faso en handicapant sa ressource humaine.
Abstract : Schistosomiasis is a water related infectious parasitosis with focal specificity caused by a worm of the genus Schistosoma. As a Neglected Tropical Disease (NTD), it severely acts in tropical and subtropical zones. This pathology represents in developing countries particularly in Burkina Faso, a public health problem of major concern. The important inconveniences notably in socio-economic terms in Burkina Faso lead to the establishment of a national fight program whose strategy is based on mass drug administration for school-aged children and high risk communities in 22 sentinel sites with praziquantel. Despite this decade of treatment, persistence with high prevalence and densities is always observed. This study aims at studying the explanatory factors of the disease. It is based on an integrated approach combining social, environmental and sanitary aspects. Regarding social aspects, this study aims at demonstrating the relevant associated factors to the disease through a socio ? anthropological survey followed by sanitary diagnostic. A multivariate analysis especially binary logistic regression was used to establish the disease transmission model by identifying the important factors associated to its occurrence. With regard to environmental aspects, the study goal is to identify the season of high incidence through a monitoring of transmission cycle parameters. As for sanitary aspects; the purpose is to evaluate the mass drug administration strategy, the diagnostic technic and method used currently. This study demonstrated that the major factors associated to the disease are the geographic position of the household then of individuals relatively to the river, the lack of sanitation i.e. opens defecation, age and contacts with water. Besides, this study allowed the identification of the warm season (March ? April) as the one of high incidence, in other words, the mass drug administration campaigns would be more efficacy at the start of the rainy season. At last, the study revealed that the treatment strategy do not assure optimal praziquantel doses whereas these doses are recommended on endemic sites such as Panamasso. Undoubtedly, this study contributes considerably to a best orientation of the fight strategy against this debilitating disease that hampers the development of Burkina Faso by handicapping its human resource.Exemplaires(0)
Disponibilité aucun exemplaire Documents numériques

FredAdobe Acrobat PDFThèse en Sciences et Technologies de l'Eau, de l'Energie et de l’Environnement. Application of Upflow Anaerobic Sludge Blanket Reactor coupled with Trickling Filters for Municipal Wastewater Treatment / Philomina Mamley Adantey ARTHUR

Titre de série : Thèse en Sciences et Technologies de l'Eau, de l'Energie et de l’Environnement Titre : Application of Upflow Anaerobic Sludge Blanket Reactor coupled with Trickling Filters for Municipal Wastewater Treatment : Technical, Environmental and economic assessment in the tropical developing country of Ghana Type de document : texte imprimé Auteurs : Philomina Mamley Adantey ARTHUR, Auteur Année de publication : 2023 Importance : 259 P. Langues : Français (fre) Résumé : La gestion des eaux usées reste un défi majeur dans la plupart des pays en développement notamment ceux d'Afrique subsaharienne confrontés au manque d'infrastructures adéquates pour la collecte, l'évacuation, et le traitement de ces eaux. Ce défi est davantage exacerbé par la croissance rapide de la population, l'urbanisation galopante et l'industrialisation. Les eaux usées non traitées contiennent pourtant des polluants divers tels que des composés toxiques et des agents pathogènes qui mettent en danger la santé publique et les écosystèmes récepteurs. Elles sont cependant composées de riches ressources telles que de l'eau douce, des nutriments et de l’'énergie qui peuvent être exploitées en utilisant des technologies adaptées et respectueuses de l'environnement, en appliquant les principes de l'économie circulaire, ce qui favoriserait une gestion durable des eaux usées. Le réacteur à lit de boues anaérobie à flux ascendant (UASB) est considéré comme une option technologique efficace de traitement des eaux usées qui a été largement mise en oeuvre dans plusieurs régions du monde, notamment en Europe, en Amérique latine et en Inde. Cette technologie est cependant moins représentée en Afrique subsaharienne malgré les conditions climatiques qui semblent être favorables à son fonctionnement. Cette étude de thèse a porté sur l’évaluation de la viabilité technique, environnementale et économique d'un réacteur UASB grandeur réelle couplé à des lits bactériens comme unités de post-traitement à la STEP de Mudor à Accra, capitale du Ghana dans la sous-région ouest-africaine. L'évaluation technique a révélé une performance satisfaisante du système UASB avec une efficacité d'élimination de plus de 70% pour les paramètres de pollutions considérés (matières solides, les matières organiques et les charges microbiennes), tandis que le post-traitement par lits bactériens a encore amélioré l'élimination de ces contaminants jusqu'aux limites acceptables fixées par l’Agence de Protection de l’Environnement (EPA) du Ghana. La quantité journalière de biogaz produite est comprise entre 101 Nm3/j et 1673 Nm3/j, avec une production moyenne journalière de à 613 ± 271 Nm3/j, correspondant à un rendement spécifique de 0.140 ± 0.07 m3biogaz/kgDCO traitée. La qualité du biogaz produit contient en moyenne 65% de méthane. Cependant, 23% du méthane généré est dissous dans l'effluent, ce qui réduit le potentiel de valorisation énergétique du biogaz. L'évaluation environnementale a utilisé la méthodologie du GIEC pour mesurer l'empreinte carbone de la station de traitement des eaux usées municipales de Mudor. L'étude a révélé que les émissions totales de gaz à effet de serre (GES) provenant des opérations de cette station s’élevaient à 39 619,36 tCO2eq/an. Les émissions de CO2 provenant de la consommation
d'énergie ont été estimées à 165,74 tCO2eq/an, soit 8,5% des émissions totales. Le méthane dissous dans les effluents a été identifié comme la source la plus importante d'émissions de GES avec une contribution de plus de 90%, soit 37 676,67 tCO2eq/an. Une analyse coûts-avantages a été utilisée pour l'évaluation économique. Elle a révélé que la gestion du personnel était responsable du pourcentage le plus élevé (37%) des charges d’exploitation, tandis que la consommation d'énergie de la station d'épuration ne représentait que 7,3% des charges globales d’exploitation. L'analyse des bénéfices effectuée en utilisant la valorisation des ressources a révélé que le potentiel de récupération d'énergie (534,1 MWh/an) à partir du biogaz et des boues générées par la station pourrait compenser complètement la demande totale d'énergie de la station (392,7 MWh/an). Il a également été constaté que l'effluent traité riche en nutriments présentait une concentration plus faible en métaux lourds et une charge microbienne acceptable pour réutilisation en agriculture. Fort de ces résultats, la technologie du réacteur UASB présente donc une alternative de traitement efficace des eaux usées, économiquement réalisable et qui peut être mise en oeuvre dans les pays en développement en vue d'une gestion des eaux usées pour le développement durable dans cette partie du monde.
Abstract : Wastewater management remains one major challenge in most developing countries in sub-Saharan Africa (SSA) due to the lack of adequate infrastructure for wastewater disposal, collection, and treatment. This challenge has been exacerbated by rapid population growth, urbanization, and industrialization. Meanwhile, untreated wastewater contains pollutants such as toxic compounds and pathogens which put at risk public health and the receiving ecosystems. Wastewater is, however, composed of rich resources such as freshwater, nutrients and energy, which can be harnessed using modern and eco-friendly technologies that employ circular economy principles, promoting sustainable wastewater management. The Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) reactor has been identified as an efficient and low-cost wastewater treatment option which has been widely implemented in several regions of the world, especially in Latin America and India. This technology is, however, less represented in SSA despite the favourable climatic conditions. This study, therefore, evaluated the technical, environmental, and economic sustainability of a full-scale UASB reactor coupled with Trickling Filters as post-treatment units in Accra, the capital city of Ghana in the West African sub-region. The technical assessment revealed satisfactory system performance with over 70% removal efficiency for solids, organic matter, and microbial loads, whilst post-treatment further enhanced the removal of these contaminants to acceptable limits set by the Environmental Protection Agency (EPA), Ghana. However, the system could not adequately remove nutrients, with nitrogen and phosphorous compounds far exceeding discharge limits. Daily biogas production was between 101 Nm3/d and 1673 Nm3/d, with an average daily production of 613 ± 271 Nm3/d, corresponding to a specific yield of 0.14 ± 0.07 m3biogas/kgCOD removed. Biogas produced contained 65% of methane. However, 23% of the methane generated remained dissolved in the effluent, reducing biogas energy recovery potential. Environmental assessment employed the IPCC GHG inventory methodology to measure the carbon footprints of the full-scale municipal wastewater treatment plant. It was found from the study that the total greenhouse gas (GHG) emissions from the operations of the Mudor Plant were estimated at 39,619.36 tCO2eq/yr. CO2 emissions from energy consumption were estimated at 165.74 tCO2eq/yr, constituting 8.5% of the total emissions. Dissolved methane in the effluent was identified as the single most significant source of GHG emissions, with over 90% contribution at 37,676.67 tCO2eq/yr. A cost-benefit analysis was employed for the economic assessment. Cost analysis revealed that staff management was responsible for the highest percentage (37%)
of the operational cost, whilst energy consumption of the anaerobic-based wastewater treatment plant was only 7.3% of the total operational cost. Benefit analysis carried out employing resource recovery revealed that energy recovery potential (534.1 MWh/yr) from biogas and sludge generated by the Plant could completely offset the total Plant energy demand (392.7 MWh/yr). Additionally, it was found that the nutrient-rich effluent had lower heavy metals concentration with acceptable microbial load count for urban irrigation. Thus, the UASB reactor technology presents an efficient, economically feasible and sustainable wastewater treatment alternative that can be implemented in developing countries towards the attainment of sustainable wastewater management for sustainable development in this part of the world.Thèse en Sciences et Technologies de l'Eau, de l'Energie et de l’Environnement. Application of Upflow Anaerobic Sludge Blanket Reactor coupled with Trickling Filters for Municipal Wastewater Treatment : Technical, Environmental and economic assessment in the tropical developing country of Ghana [texte imprimé] / Philomina Mamley Adantey ARTHUR, Auteur . - 2023 . - 259 P.
Langues : Français (fre)
Résumé : La gestion des eaux usées reste un défi majeur dans la plupart des pays en développement notamment ceux d'Afrique subsaharienne confrontés au manque d'infrastructures adéquates pour la collecte, l'évacuation, et le traitement de ces eaux. Ce défi est davantage exacerbé par la croissance rapide de la population, l'urbanisation galopante et l'industrialisation. Les eaux usées non traitées contiennent pourtant des polluants divers tels que des composés toxiques et des agents pathogènes qui mettent en danger la santé publique et les écosystèmes récepteurs. Elles sont cependant composées de riches ressources telles que de l'eau douce, des nutriments et de l’'énergie qui peuvent être exploitées en utilisant des technologies adaptées et respectueuses de l'environnement, en appliquant les principes de l'économie circulaire, ce qui favoriserait une gestion durable des eaux usées. Le réacteur à lit de boues anaérobie à flux ascendant (UASB) est considéré comme une option technologique efficace de traitement des eaux usées qui a été largement mise en oeuvre dans plusieurs régions du monde, notamment en Europe, en Amérique latine et en Inde. Cette technologie est cependant moins représentée en Afrique subsaharienne malgré les conditions climatiques qui semblent être favorables à son fonctionnement. Cette étude de thèse a porté sur l’évaluation de la viabilité technique, environnementale et économique d'un réacteur UASB grandeur réelle couplé à des lits bactériens comme unités de post-traitement à la STEP de Mudor à Accra, capitale du Ghana dans la sous-région ouest-africaine. L'évaluation technique a révélé une performance satisfaisante du système UASB avec une efficacité d'élimination de plus de 70% pour les paramètres de pollutions considérés (matières solides, les matières organiques et les charges microbiennes), tandis que le post-traitement par lits bactériens a encore amélioré l'élimination de ces contaminants jusqu'aux limites acceptables fixées par l’Agence de Protection de l’Environnement (EPA) du Ghana. La quantité journalière de biogaz produite est comprise entre 101 Nm3/j et 1673 Nm3/j, avec une production moyenne journalière de à 613 ± 271 Nm3/j, correspondant à un rendement spécifique de 0.140 ± 0.07 m3biogaz/kgDCO traitée. La qualité du biogaz produit contient en moyenne 65% de méthane. Cependant, 23% du méthane généré est dissous dans l'effluent, ce qui réduit le potentiel de valorisation énergétique du biogaz. L'évaluation environnementale a utilisé la méthodologie du GIEC pour mesurer l'empreinte carbone de la station de traitement des eaux usées municipales de Mudor. L'étude a révélé que les émissions totales de gaz à effet de serre (GES) provenant des opérations de cette station s’élevaient à 39 619,36 tCO2eq/an. Les émissions de CO2 provenant de la consommation
d'énergie ont été estimées à 165,74 tCO2eq/an, soit 8,5% des émissions totales. Le méthane dissous dans les effluents a été identifié comme la source la plus importante d'émissions de GES avec une contribution de plus de 90%, soit 37 676,67 tCO2eq/an. Une analyse coûts-avantages a été utilisée pour l'évaluation économique. Elle a révélé que la gestion du personnel était responsable du pourcentage le plus élevé (37%) des charges d’exploitation, tandis que la consommation d'énergie de la station d'épuration ne représentait que 7,3% des charges globales d’exploitation. L'analyse des bénéfices effectuée en utilisant la valorisation des ressources a révélé que le potentiel de récupération d'énergie (534,1 MWh/an) à partir du biogaz et des boues générées par la station pourrait compenser complètement la demande totale d'énergie de la station (392,7 MWh/an). Il a également été constaté que l'effluent traité riche en nutriments présentait une concentration plus faible en métaux lourds et une charge microbienne acceptable pour réutilisation en agriculture. Fort de ces résultats, la technologie du réacteur UASB présente donc une alternative de traitement efficace des eaux usées, économiquement réalisable et qui peut être mise en oeuvre dans les pays en développement en vue d'une gestion des eaux usées pour le développement durable dans cette partie du monde.
Abstract : Wastewater management remains one major challenge in most developing countries in sub-Saharan Africa (SSA) due to the lack of adequate infrastructure for wastewater disposal, collection, and treatment. This challenge has been exacerbated by rapid population growth, urbanization, and industrialization. Meanwhile, untreated wastewater contains pollutants such as toxic compounds and pathogens which put at risk public health and the receiving ecosystems. Wastewater is, however, composed of rich resources such as freshwater, nutrients and energy, which can be harnessed using modern and eco-friendly technologies that employ circular economy principles, promoting sustainable wastewater management. The Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) reactor has been identified as an efficient and low-cost wastewater treatment option which has been widely implemented in several regions of the world, especially in Latin America and India. This technology is, however, less represented in SSA despite the favourable climatic conditions. This study, therefore, evaluated the technical, environmental, and economic sustainability of a full-scale UASB reactor coupled with Trickling Filters as post-treatment units in Accra, the capital city of Ghana in the West African sub-region. The technical assessment revealed satisfactory system performance with over 70% removal efficiency for solids, organic matter, and microbial loads, whilst post-treatment further enhanced the removal of these contaminants to acceptable limits set by the Environmental Protection Agency (EPA), Ghana. However, the system could not adequately remove nutrients, with nitrogen and phosphorous compounds far exceeding discharge limits. Daily biogas production was between 101 Nm3/d and 1673 Nm3/d, with an average daily production of 613 ± 271 Nm3/d, corresponding to a specific yield of 0.14 ± 0.07 m3biogas/kgCOD removed. Biogas produced contained 65% of methane. However, 23% of the methane generated remained dissolved in the effluent, reducing biogas energy recovery potential. Environmental assessment employed the IPCC GHG inventory methodology to measure the carbon footprints of the full-scale municipal wastewater treatment plant. It was found from the study that the total greenhouse gas (GHG) emissions from the operations of the Mudor Plant were estimated at 39,619.36 tCO2eq/yr. CO2 emissions from energy consumption were estimated at 165.74 tCO2eq/yr, constituting 8.5% of the total emissions. Dissolved methane in the effluent was identified as the single most significant source of GHG emissions, with over 90% contribution at 37,676.67 tCO2eq/yr. A cost-benefit analysis was employed for the economic assessment. Cost analysis revealed that staff management was responsible for the highest percentage (37%)
of the operational cost, whilst energy consumption of the anaerobic-based wastewater treatment plant was only 7.3% of the total operational cost. Benefit analysis carried out employing resource recovery revealed that energy recovery potential (534.1 MWh/yr) from biogas and sludge generated by the Plant could completely offset the total Plant energy demand (392.7 MWh/yr). Additionally, it was found that the nutrient-rich effluent had lower heavy metals concentration with acceptable microbial load count for urban irrigation. Thus, the UASB reactor technology presents an efficient, economically feasible and sustainable wastewater treatment alternative that can be implemented in developing countries towards the attainment of sustainable wastewater management for sustainable development in this part of the world.Exemplaires(0)
Disponibilité aucun exemplaire Documents numériques

MamleyAdobe Acrobat PDFThèse en Sciences et Technologies de l'Eau, de l'Energie et de l’Environnement. Approches technico-économiques d’optimisation des systèmes énergétiques décentralisés / David Blaise TSUANYO

PermalinkThèse en Sciences et Technologies de l'Eau, de l'Energie et de l’Environnement. De « Bancoville » à la construction postmatérialiste / Ousmane ZOUNGRANA

PermalinkThèse en Sciences et Technologies de l'Eau, de l'Energie et de l’Environnement. Bâtiment et bioclimatisme en Afrique subsaharienne / Ibrahim NEYA

PermalinkThèse en Sciences et Technologies de l'Eau, de l'Energie et de l’Environnement. Caractérisation géomécanique de sols bruts et traités pour une meilleure utilisation en construction routière / Marie Thérèse Marame MBENGUE

PermalinkThèse en Sciences et Technologies de l'Eau, de l'Energie et de l’Environnement. Caractérisation et modélisation hydrogéologique d’un aquifère en milieu de socle fracturé / Donissongou Dimitri SORO

PermalinkThèse en Sciences et Technologies de l'Eau, de l'Energie et de l’Environnement. Caractérisation et modélisation du transfert de polluants dans un aquifère fracture en milieu de socle (Sous bassin versant de la Sissili – Burkina) / Moussa Diagne FAYE

PermalinkThèse en Sciences et Technologies de l'Eau, de l'Energie et de l’Environnement. Catalyseurs hétérogènes basiques à base de latérites et de potassium pour la production du biodiesel / Emma Brice HAPPI TCHUESSA

PermalinkThèse en Sciences et Technologies de l'Eau, de l'Energie et de l’Environnement. Comportement physico-mécanique et durabilité de béton géopolymère sous une cure a température ambiante dans le contexte du climat subsahélien (Burkina Faso) / Yawo Daniel ADUFU

PermalinkThèse en Sciences et Technologies de l'Eau, de l'Energie et de l’Environnement. Comportement physico-mécanique et durabilité de mortiers cimentaires à granulats de mâchefer / Yaovi Edem BAITE

PermalinkThèse en Sciences et Technologies de l'Eau, de l'Energie et de l’Environnement. Compréhension et caractérisation de l’intermittence du réseau hydrographique en Afrique / Patindé Axel BELEMTOUGRI

Permalink